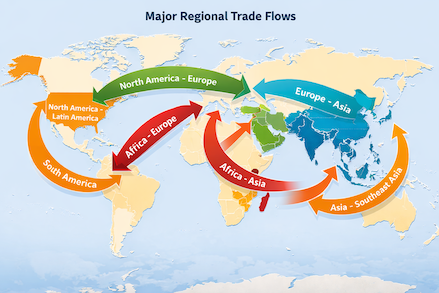Muzinich & Co.: Weekly Update – Blues sur le cuivre

La semaine dernière, les cours ont été modérés dans la plupart des classes d’actifs. Les rendements des obligations d’État sont restés relativement stables, tandis que les marchés du crédit aux entreprises ont évolué dans une fourchette étroite, les investisseurs se concentrant sur les coupons. Le dollar américain s’est négocié à un niveau stable, tout comme les marchés de l’énergie, malgré l’annonce par l’OPEP+ d’une nouvelle augmentation de la production de 548 000 barils par jour pour le mois d’août.
Les marchés actions ont été globalement positifs, l’Europe surperformant tandis que l’Amérique latine était à la traîne. L’indice Bloomberg World Large & Mid Cap a clôturé la semaine en hausse de 0,75 %. L’absence relative de mouvement des cours peut s’expliquer par la fatigue des marchés, le calme estival habituel ou un calendrier économique peu chargé qui n’a apporté que peu d’informations nouvelles.
De la déflation en Chine
Parmi les faits marquants de la semaine sur le plan économique, les données chinoises ont montré que la déflation se poursuit, malgré les efforts déployés par le gouvernement. En juin, l’indice des prix à la consommation a reculé de 0,1 % en glissement mensuel, après une baisse de 0,2 % en mai, et a reculé de 0,1 % en glissement annuel pour le premier semestre.Dans le même temps, l’indice des prix à la production a reculé de 0,4 % en juin et de 2,8 % au premier semestre.
Les principaux facteurs à l’origine de la déflation persistante incluent les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur les produits chinois, la baisse de la demande extérieure et des anticipations de revenus, ainsi que la faiblesse prolongée du secteur immobilier résidentiel. Ensemble, ces facteurs continuent de l’emporter sur les efforts du gouvernement pour relancer l’économie, qui se sont concentrés sur la stimulation de la consommation.
Aux États-Unis, la publication du procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 17 et 18 juin a révélé que la Fed considère sa politique monétaire comme modérément restrictive, mais estime que la prudence est de mise dans l’attente d’une clarification des perspectives économiques. Les membres du Comité ont souligné l’importance de maintenir les anticipations d’inflation à un niveau stable, d’autant plus que les effets des mesures tarifaires et des politiques d’immigration américaines continuent de se répercuter sur l’économie.
Bien que le moment, l’ampleur et la duration de ces répercussions sur la croissance et l’inflation demeurent incertains, le Comité s’attend généralement à ce qu’elles s’atténuent au deuxième semestre, ouvrant la voie à une réduction du taux des fonds fédéraux avant la fin de l’année. Compte tenu de ces perspectives, le marché des swaps indexés sur le taux au jour le jour (OIS) table actuellement sur une probabilité de 70 % d’une réduction des taux lors de la réunion du FOMC de septembre.
Le plus grand showman
En l’absence d’autres éléments susceptibles d’attirer l’attention des investisseurs, Donald Trump a (une nouvelle fois) occupé le devant de la scène la semaine dernière. Fidèle à lui-même, il n’a pas déçu. Il a tout d’abord annoncé qu’aucune prolongation ne serait accordée au-delà de la date limite du 1er août pour les droits de douane réciproques. Il a ensuite dévoilé la première d’une série de lettres très attendues menaçant d’augmenter les droits de douane sur les principaux partenaires commerciaux si aucun accord n’était conclu.
À compter du 1er août, les produits en provenance du Japon et de la Corée du Sud seront soumis à des droits de douane de 25 %. Le même taux de 25 % s’appliquera aux importations en provenance de Malaisie et du Kazakhstan, tandis que l’Afrique du Sud sera soumise à des droits de douane de 30 % et le Laos et le Myanmar à des droits de 40 %. Le président Trump a déclaré à NBC News qu’il prévoyait d’appliquer des droits de douane de 15 à 20 % à la plupart des autres partenaires commerciaux.
Il existe toutefois deux exceptions notables, le Canada et le Brésil. Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 35 % sur certains produits canadiens à compter du 1er août. Cela représente une augmentation par rapport aux droits de douane de 25 % actuellement appliqués aux importations américaines en provenance du Canada qui ne sont pas couvertes par l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC). Dans une lettre adressée au Premier ministre canadien Mark Carney, Trump a critiqué les pratiques commerciales du Canada, affirmant que le pays maintien de nombreuses « politiques tarifaires, non tarifaires et barrières commerciales » qui contribuent à des déficits commerciaux insoutenables pour les États-Unis.
La menace contre le Brésil ne peut pas être motivée par des pratiques commerciales jugées déloyales. Le Brésil importe depuis toujours plus de marchandises des États-Unis qu’il n’en exporte et affiche un déficit commercial persistant avec les États-Unis depuis de nombreuses années. Rien qu’en 2024, le Brésil a dépensé 7,4 milliards de dollars de plus en marchandises américaines qu’il n’a gagné grâce à ses exportations vers les États-Unis.
Malgré cela, Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient un droit de douane de 50 % sur tous les produits importés du Brésil à compter du 1er août. Après prise en compte des droits de douane spécifiques à certains secteurs et des exemptions, le nouveau taux moyen effectif des droits de douane du Brésil sur les exportations américaines passera de 10,5 % à 36,1 %.
Cela laisse penser que la décision de Trump de cibler le Brésil est davantage politique que commerciale. Dans sa lettre au Brésil, publiée sur son compte de réseau social, Trump a déclaré qu’il prenait cette décision « en partie en raison des attaques insidieuses du Brésil contre les élections libres et les droits fondamentaux des Américains à la liberté d’expression ».
Si le nouveau droit de douane venait à entrer en vigueur, il pourrait avoir un impact significatif sur la croissance brésilienne. Cela survient à un moment difficile pour le président Lula, qui doit déjà faire face à un ralentissement économique, à des perspectives budgétaires fragiles et à une insatisfaction croissante des électeurs à l’approche des élections de l’année prochaine. Nous pensons que les négociations entre les États-Unis et le Brésil vont se poursuivre, d’autant plus que le recours à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux semble difficile à justifier compte tenu de l’excédent commercial des États-Unis avec le Brésil.
Préparez-vous à la riposte
Cependant, s’il s’agit d’un nouvel exemple des efforts déployés par Trump pour empiéter sur la souveraineté d’autres nations, à l’instar de ses actions envers le Canada, le Panama, le changement de nom du golfe du Mexique ou sa tentative de prendre le contrôle du Groenland au Danemark, cela pourrait se retourner contre lui. De telles mesures risquent de galvaniser le soutien nationaliste en faveur de Lula sur le terrain de la souveraineté, renforçant ainsi sa position à un moment où il aurait autrement couru un risque élevé de perdre les prochaines élections.
Au-delà des gros titres sur les droits de douane réciproques, un risque souvent négligé est l’annonce par le président Trump de droits de douane de 50 % sur les importations de cuivre à compter du 1er août. Cela pourrait avoir de graves répercussions sur les fabricants américains dans des secteurs tels que l’automobile, la construction et l’électroménager, où le cuivre est essentiel. On ne sait pas encore quels produits à base de cuivre seront concernés, mais les États-Unis ont importé environ 908 kilotonnes de cuivre en 2024, principalement raffiné, avec une dépendance nette à l’importation de 45 %.
Le déficit intérieur résulte à la fois d’une offre insuffisante de minerai et de ferraille et d’une capacité de fusion/raffinage limitée. Pour rétablir l’équilibre, il faudrait augmenter l’offre primaire et secondaire, en partie en réduisant les exportations de ferraille et en développant le raffinage national. Toutefois, le coût élevé des investissements et les longs délais nécessaires aux projets d’exploitation minière ou de fusion, combinés à l’incertitude politique, rendent peu probable tout investissement à court terme. Même dans des conditions idéales, le rétablissement de la balance commerciale du cuivre prendrait au moins trois à cinq ans.
Dans l’intervalle, les prix du cuivre aux États-Unis devraient augmenter de près de 40 % par rapport à leur niveau d’avant les droits de douane, en supposant une destruction partielle seulement de la demande. L’impact réel dépendra fortement de l’élasticité de la demande intérieure de cuivre. Comme le montre notre « Graphique de la semaine », les prix du cuivre sur le New York Mercantile Exchange ont déjà bondi de 25 % par rapport à ceux du London Metal Exchange.
Ces droits de douane constituent un exemple typique de choc d’offre susceptible de freiner la croissance et de faire grimper l’inflation.
Graphique de la semaine: choc des prix du cuivre
London Metal Exchange, New York Mercantile Exchange, prix du cuivre, au 11 juillet 2025. À titre indicatif uniquement.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Business