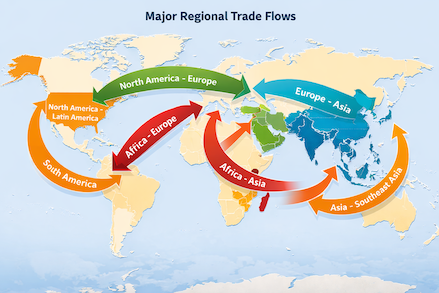Muzinich & Co.: Weekly Update – 100 premiers jours de la nouvelle administration américaine

Franklin D. Roosevelt (FDR) est devenu président des États-Unis en 1933, au plus fort de la Grande Dépression. Son administration n’a pas perdu de temps et a fait adopter par le Congrès 15 lois majeures au cours des 100 premiers jours de son mandat, incluant des réformes bancaires, des programmes d’aide aux demandeurs d’emploi et des initiatives de soutien à l’agriculture.[1] FDR a inventé l’expression « les 100 premiers jours », qui est depuis lors devenue une référence symbolique pour mesurer l’efficacité d’un président.
Pour tout nouveau président, les 100 premiers jours constituent généralement une période dynamique, une fenêtre d’opportunité pour afficher ses priorités, son style de leadership et sa vision, tout en renforçant la crédibilité de son administration. Pour les investisseurs, cette période peut toutefois être tendue, marquée par des changements de politique, des risques liés à l’actualité et des incertitudes.
L’histoire récente souligne l’importance des 100 premiers jours. En 1961, John F. Kennedy a essuyé un revers majeur avec l’échec de l’invasion de la baie des Cochons, une tentative de renversement du régime communiste de Fidel Castro à Cuba.[2] En 1981, Ronald Reagan a rapidement mis en œuvre un programme de réduction d’impôts de grande envergure. [3] En 2009, en pleine crise financière mondiale, Barack Obama a adopté l’American Recovery and Reinvestment Act, un plan de relance de 800 milliards de dollars américains.[4] Et en 2021, Joe Biden a signé l’American Rescue Plan, un plan de relance de 1 900 milliards de dollars américains destiné à lutter contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.[5]
Misez sur la liberté
Pour Donald Trump, président réélu pour un second mandat, l’événement marquant des 100 premiers jours de son administration a été le « Jour de la libération », en référence à sa tentative agressive de redéfinir les relations commerciales des États-Unis par le biais d’un décret présidentiel instaurant des droits de douane réciproques à l’échelle mondiale.
Les investisseurs ont eu un premier aperçu des effets chiffrés du Liberation Day cette semaine avec la publication des données du PIB réel du premier trimestre, qui ont montré une contraction de l’économie pour la première fois depuis 2022, avec une baisse de la production de 0,3 %.[6] Cette faiblesse est entièrement due à une forte augmentation des importations, qui a soustrait près de 5 % au résultat global.
Les résultats financiers des entreprises au premier trimestre font apparaître de nouveaux signes de pression économique. McDonald’s Corp. a annoncé une forte baisse de ses ventes aux États-Unis, soulignant la détérioration de la confiance des consommateurs, qui rend de plus en plus difficile pour les restaurants d’attirer des clients.[7] Les ventes à périmètre constant aux États-Unis ont chuté de 3,6 %, la plus forte baisse depuis que la pandémie a contraint les clients à rester chez eux. Ces résultats décevants font suite à des performances tout aussi faibles de Chipotle Mexican Grill et Starbucks.[8]
À la traîne
Dans la recherche d’une feuille de route économique pour le Liberation Day, les comparaisons avec la première partie du mandat de Trump sont insuffisantes. Au cours de son premier essai, les droits de douane ont été largement concentrés sur la Chine et un nombre limité d’industries historiquement protégées, telles que l’aluminium et l’acier. Cela a permis aux importateurs américains de s’approvisionner dans des pays autres que la Chine, rendant les prix relativement élastiques. La charge des droits de douane a été répartie entre les exportateurs étrangers (par le biais d’ajustements monétaires), les chaînes d’approvisionnement des entreprises et les consommateurs.
La deuxième fois, les droits de douane unilatéraux ont renversé la situation, car les producteurs étrangers sont moins incités à faire des concessions. En conséquence, les entreprises et les consommateurs américains deviendront de plus en plus des preneurs de prix, car les alternatives de fabrication nationale restent limitées à court terme. Il s’agit là d’un exemple classique de choc négatif du côté de l’offre.
L’exemple le plus récent d’un tel choc s’est produit pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, en tant que feuille de route économique pour le Liberation Day, la nature des chocs est très différente. Pendant la pandémie, le catalyseur a été l’arrêt soudain et inattendu de la production et des chaînes d’approvisionnement lorsque le monde est entré en confinement, ce qui a entraîné une forte contraction de la capacité de production. En revanche, le choc provoqué par le Liberation Day résulte d’une augmentation inattendue des coûts des biens dans l’ensemble de l’économie, en particulier les prix des intrants.
Quand les choses se gâtent
Malgré des causes différentes, ces deux scénarios ont des conséquences économiques similaires : un déplacement vers la gauche de la courbe de l’offre agrégée à court terme (SRAS), entraînant une baisse de la production, un ralentissement de la croissance économique, une hausse du chômage et une augmentation des prix, un cas d’école d’inflation par les coûts.
Il existe toutefois une distinction importante entre un choc d’offre provoqué par une hausse soudaine des prix des intrants et un choc provoqué par une baisse soudaine de la capacité de production. Dans le premier cas, le choc est lié aux coûts et l’inflation est en quelque sorte incorporée dans la hausse des coûts des intrants. Les mesures de politique monétaire et budgétaire sont alors inefficaces, car stimuler la demande risquerait d’alimenter davantage l’inflation.
Du côté positif, la reprise potentielle peut souvent se produire plus rapidement une fois que les prix se stabilisent, voire se normalisent, ce qui permet à la production et à la confiance de rebondir plus rapidement. Cela explique en partie pourquoi la Réserve fédérale américaine préfère adopter une approche attentiste, tout en maintenant ses taux directeurs à des niveaux restrictifs supérieurs à leur niveau neutre. Actuellement, le marché des swaps de taux d’intérêt au jour le jour table sur une probabilité de 55 % que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base en juin. [9]
Inspiré par le Brexit
Une autre école de pensée considère le Liberation Day comme le Brexit américain. Le président Trump a fortement soutenu le Brexit, le qualifiant de « grande chose » et félicitant le Royaume-Uni d’avoir « repris son pays » en votant pour quitter l’Union européenne. [10]
Le Brexit et la politique tarifaire américaine reflètent tous deux un glissement vers le nationalisme économique, une approche protectionniste qui privilégie la souveraineté nationale et les intérêts nationaux au détriment de la mondialisation. Ces mesures trouvent leur origine dans la volonté de réduire l’influence étrangère et la dépendance économique, dans le but de protéger les industries nationales contre ce qui est perçu comme une concurrence ou des pressions mondiales déloyales.
Le Brexit n’est peut-être pas un échec total, mais on peut aussi dire qu’il n’a pas tenu les promesses les plus audacieuses de ses partisans. Le Royaume-Uni a désormais le contrôle total de ses lois et réglementations, et les électeurs comprennent clairement que les responsables politiques nationaux sont seuls responsables, sans pouvoir rejeter la faute sur les institutions européennes.
En matière de souveraineté, le Royaume-Uni a repris le contrôle de ses frontières, mettant en place un système d’immigration à points qui traite de manière égale les citoyens de l’UE et ceux des pays tiers. Il a également repris le contrôle de sa politique commerciale, signant plusieurs accords commerciaux indépendants, notamment avec l’Australie et le Japon, et a révisé son partenariat avec l’UE dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération. [11]
Courte paille
Toutefois, en tant que feuille de route économique, l’administration américaine devrait tenir compte des lacunes du Brexit. Depuis le référendum de 2016 sur l’UE, le Royaume-Uni a constamment affiché des résultats inférieurs à ceux des autres économies avancées, connaissant à la fois une croissance plus lente et une inflation plus élevée. [12]
Les économistes s’accordent à dire que le Brexit entraînera une baisse du PIB à long terme d’environ 5 % par rapport à un scénario dans lequel le Royaume-Uni serait resté dans l’UE. Ce manque à gagner est largement attribué à un déclin soutenu des échanges commerciaux et des investissements, les nouvelles barrières rendant le Royaume-Uni moins attractif pour les entreprises et le commerce transfrontalier.
Le troisième impact du Brexit sur l’économie britannique est la réduction de l’immigration en provenance de l’UE. En théorie économique, lorsque l’offre de main-d’œuvre diminue, le potentiel de production à long terme diminue également. Cependant, l’effet le plus immédiat s’est fait sentir au niveau de l’inflation. La fin de la libre circulation a considérablement réduit l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre, rendant le marché du travail plus cyclique et plus sujet aux pressions inflationnistes.[13]
Cette évolution a contribué à la flambée de l’inflation après la pandémie et devrait maintenir la tension sur le marché du travail dans des secteurs clés tels que l’hôtellerie, l’agriculture, les soins de santé et la logistique, qui ont toujours été fortement tributaires des travailleurs de l’UE et ont connu de graves pénuries de main-d’œuvre. En outre, les entreprises britanniques sont désormais confrontées à des charges réglementaires et administratives accrues dans leurs échanges commerciaux avec l’UE, notamment des formalités administratives supplémentaires et des coûts de mise en conformité.
Dans l’ensemble, ces évolutions suggèrent que le recul de l’immigration dans l’UE a contribué à une rigidité accrue du marché du travail, à des pressions salariales plus fortes et à un profil d’inflation plus persistant dans l’économie britannique post-Brexit.
Pour finir, le gouvernement conservateur a été évincé du pouvoir de manière décisive en 2024, remportant seulement 121 sièges sur 650, son pire résultat électoral depuis la fondation du parti au XIXe siècle.[14]
Les répercussions économiques du Brexit ont clairement contribué à cette situation, comme en témoigne le revirement significatif de l’opinion publique. Selon des sondages récents, les Britanniques sont désormais plus nombreux à considérer le Brexit comme une erreur plutôt que comme une réussite (voir le graphique de la semaine).[15]
Rime ou raison ?
Mark Twain a dit un jour que « l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent ». En tant qu’investisseurs, nous ne devrions pas être surpris que les 100 premiers jours d’un nouveau président aient été marqués par des tensions économiques et une volatilité des marchés, ni que ces turbulences puissent persister dans un contexte d’incertitude politique.
Le Liberation Day représente un choc d’offre brutal pour l’économie américaine, alimentant une inflation par les coûts. Dans ce contexte, l’ajustement monétaire naturel devrait se produire via les marchés des devises, notamment sous la forme d’une faiblesse du dollar américain, les outils conventionnels de taux d’intérêt restant largement inefficaces contre l’inflation par l’offre.
Cette dynamique devrait inciter le FOMC à rester dans l’expectative, évaluant si l’effet combiné du resserrement des conditions financières risque de freiner l’économie dans son ensemble.
À plus long terme, le déficit courant américain pourrait se réduire, mais au prix d’un affaiblissement de la croissance à long terme et d’une inflation plus persistante, sous l’effet de la rigidité du marché du travail et de la baisse des investissements directs étrangers. En fin de compte, cela pourrait entraîner une accentuation de la pentification de la courbe des taux des bons du Trésor américain.
Graphique de la semaine : Effondrement du soutien au Brexit
Source: YouGov, Public support for Brexit, as of January 28, 2025. For illustrative purposes only.
References:
[1] Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, ‘FDR’s first 100 days,’ as of May 2025
[2] US Office of the Historian, ‘The Bay of Pigs Invasion and its Aftermath,’ as of May 2025
[3] The New York Times, ‘Reagan’s first 100 days,’ April 26, 1981
[4] National Archives, First 100 days report,’ April 21, 2009
[5] The American Presidency Project, ‘Biden in Action: the first 100 days,’ April 26, 2021
[6] Bureau of Economic Analysis, ‘GDP Q1, 2025,’ April 30, 2025
[7] Macdonald’s Corporation, Q1, 2025 Results, May 1, 2025
[8] Bloomberg, ‘McDonald’s sales miss highlights rising consumer anxiety,’ May 1, 2025
[9] Bloomberg, World Interest Rate Probabilities, as of May 2, 2025
[10] Reuters, ‘Factbox: Donald Trump in his own words on Brexit, Britain and Boris,’ June 3, 2019
[11] European Commission, ‘The EU-UK Trade and Cooperation Agreement,’ April 30, 2021
[12] Office for Budget Responsibility, Brexit analysis, as of May 2025
[13] CEPR, ‘Brexit inflation: The role of trade policy uncertainty in increasing UK import prices,’ December 22, 2023
[14] BBC News, ‘UK election: What’s happened and what comes next?’ July 4, 2024
[15] YouGov, ‘How do Britons feel about Brexit five years on?’ January 28, 2025
Retrouvez l’ensemble de nos articles Business