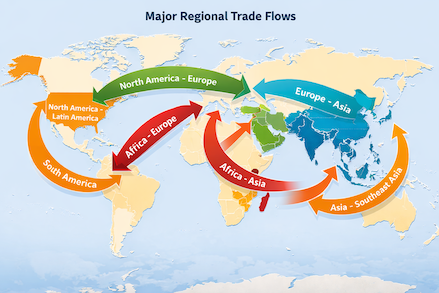Les dictateurs qui ne disent pas leur nom

Quand les urnes deviennent des trônes et que la démocratie se travestit en pouvoir absolu.
Ils se font appeler présidents, chefs d’État ou pères de la nation. Ils ont prêté serment au nom du peuple, brandi la démocratie comme un drapeau et juré de respecter la Constitution. Pourtant, une fois élus, ils s’y accrochent comme à un trône, tordant les lois, muselant la presse, écartant les opposants. Ils se disent légitimes, mais leur légitimité s’effrite au fil des années. Ces hommes, et parfois ces clans, incarnent une forme moderne de dictature : celle qui s’exerce sous le vernis des urnes.
En Afrique, la démocratie a souvent été promise comme un horizon, mais elle s’est trop souvent arrêtée aux frontières du pouvoir. Dans plusieurs pays, les élections sont devenues un rituel vidé de son sens. On y vote, certes, mais le résultat est connu d’avance : les urnes sont scellées avant même d’être ouvertes. Les opposants sont emprisonnés ou « disqualifiés » par des lois sur mesure, la presse est muselée ou achetée, et le peuple, épuisé par la peur et la misère, finit par se taire.
La dictature en costume-cravate
Les dictateurs d’aujourd’hui ont compris une chose : il ne suffit plus de prendre le pouvoir par la force, il faut le légitimer par les formes. Ils organisent des élections, convoquent des sommets internationaux, parlent de transparence et de développement. Ils savent qu’il faut paraître démocrate pour continuer à bénéficier des aides, des investissements et du soutien diplomatique. Ils ont troqué les uniformes militaires pour des costumes trois-pièces, mais la logique demeure la même : le pouvoir d’abord, le peuple ensuite. Certains manipulent la Constitution pour s’octroyer un mandat de plus ; d’autres instrumentalisent la religion ou le nationalisme pour étouffer toute opposition. Tous partagent la même obsession : durer, coûte que coûte.
Pourtant, cette confiscation du pouvoir ne serait pas possible sans la complicité silencieuse des puissances occidentales. Celles-ci oscillent entre indignation et pragmatisme : on dénonce les atteintes aux droits humains à Addis-Abeba ou à Bruxelles, tout en signant des contrats miniers ou militaires avec les mêmes régimes. On ferme les yeux sur les fraudes électorales tant que les intérêts économiques et géostratégiques sont préservés. Le discours est connu : « mieux vaut un régime autoritaire stable qu’un pays en chaos. » Mais ce calcul cynique finit toujours par nourrir la colère et la défiance. Ces dirigeants ne gouvernent pas pour leur peuple : ils gouvernent pour leurs clans, leurs bailleurs, leurs alliés. Ils construisent des routes pour les investisseurs étrangers, pas pour les paysans. Ils érigent des zones économiques spéciales, pas des écoles. Et pendant que les élites s’enrichissent, la jeunesse regarde la Méditerranée comme une issue. La complicité occidentale n’est pas seulement politique : elle est financière et morale. En soutenant ces régimes, directement ou par inertie, l’Occident contribue à perpétuer un modèle de dépendance et d’injustice.
Quand le silence précède la révolte
Où se trouve la vérité dans tout cela ? Dans les discours officiels ? Dans les urnes verrouillées ? Ou dans le regard de ces citoyens qui n’y croient plus ? La vérité, c’est que beaucoup de ces dirigeants ne gouvernent pas par amour du pouvoir, mais par peur du vide. Quitter le pouvoir, c’est perdre l’impunité, les privilèges, parfois la vie. Alors, ils s’y accrochent jusqu’à la dernière heure, quitte à entraîner leur pays dans la chute. Ils gouvernent contre vents et marées parce qu’ils savent que les institutions ne sont fortes que là où le peuple est vigilant. Et quand la société civile est muselée, la démocratie devient façade.
Pourtant, un vent nouveau souffle. Des jeunes, des femmes, des journalistes, des activistes refusent désormais de se taire. Ils savent que le changement ne viendra pas des palais, mais des consciences. L’Afrique n’est pas condamnée à répéter ses tragédies ; elle cherche sa vérité : celle d’une démocratie réelle, vivante, populaire, débarrassée des faux-semblants et des tutelles. Car un jour ou l’autre, même les dictateurs qui ne disent pas leur nom devront affronter le silence de leurs peuples, ce silence lourd, profond, celui qui précède toutes les révolutions.
« Ils ont troqué les uniformes militaires pour des costumes trois-pièces, mais la logique demeure la même : le pouvoir d’abord, le peuple ensuite. »
Retrouvez l’ensemble de nos articles Leadership