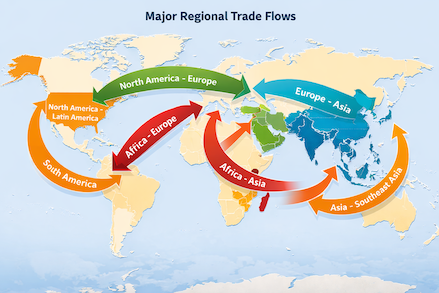Le culte du leader fort aux États-Unis

Comment en est-on arrivé là ? L’Amérique, longtemps perçue comme le phare de la démocratie libérale, semble rejouer aujourd’hui un vieux scénario, celui du Far West, où un seul homme imposait sa loi. Depuis des décennies, la confiance dans les institutions s’effrite : selon le Pew Research Center, à peine deux citoyens sur dix croient encore en leur gouvernement fédéral. Les crises ont fragilisé le tissu social : la récession de 2008 a laminé la classe moyenne, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les inégalités abyssales du système de santé, l’inflation et les tensions géopolitiques avec la Chine et la Russie nourrissent un sentiment d’insécurité permanent. Dans ce climat, beaucoup se tournent vers l’idée du « sauveur » plutôt que vers des institutions jugées lentes, bureaucratiques, incapables de protéger efficacement. L’image du shérif qui surgit pour rétablir l’ordre en dehors des procédures trouve ainsi une résonance nouvelle : la démocratie n’apparaît plus comme un rempart, mais comme un obstacle.
Le problème, c’est que cette tentation s’enracine dans une fracture profonde entre deux Amériques qui ne se parlent plus. D’un côté, l’Amérique des grandes métropoles, diverse, ouverte sur le monde, qui se veut progressiste, éduquée et tournée vers l’innovation. De l’autre, une Amérique rurale, conservatrice, attachée à la tradition et aux symboles nationaux, qui se sent marginalisée et méprisée. Ces deux univers vivent désormais en vase clos, chacun alimenté par ses propres médias, ses réseaux sociaux, ses certitudes. Le compromis, moteur historique du système américain, est devenu impossible. L’élection présidentielle ne sert plus à arbitrer des visions de société, mais à sacrer le chef d’un camp, perçu par ses partisans comme le seul capable de défendre leur identité contre « l’ennemi intérieur ». Dans cette logique, le président cesse d’être le garant des institutions pour devenir une figure quasi tribale, un totem autour duquel s’organise la loyauté politique. C’est dans ce contexte que resurgit la figure du cowboy. Dans l’imaginaire collectif américain, il incarne la force brute et la capacité à rétablir un ordre que la loi échoue à garantir. Le cowboy agit vite, souvent seul, armé de son courage et de son revolver. Il est à la fois l’homme de justice et l’homme de violence, le héros qui libère une ville de la tyrannie mais qui, en chemin, piétine les règles communes. Ce mythe séduit aujourd’hui ceux qui considèrent que Washington ne répond plus, que la bureaucratie freine l’action, que le peuple a besoin d’un justicier plus que d’un législateur. Mais derrière cette nostalgie se cache une illusion dangereuse : le cowboy n’a jamais représenté la collectivité, seulement son propre bon vouloir. En exaltant cette figure, les États-Unis risquent de basculer d’une démocratie institutionnelle, fondée sur la lenteur, le compromis, la règle partagée, vers une démocratie incarnée, où le pouvoir repose sur une seule personne, placée au-dessus des contre-pouvoirs et légitimée par l’émotion plus que par la raison.
La question qui se pose désormais dépasse largement les frontières américaines : dans un monde marqué par les crises successives, voulons-nous encore défendre des démocraties imparfaites, parfois frustrantes, mais collectives, ou sommes-nous prêts à céder à la tentation du « cowboy providentiel » ? L’Amérique, hier modèle et exportatrice de démocratie, nous renvoie aujourd’hui ce miroir troublant. La dérive vers le pouvoir incarné n’est pas un phénomène isolé : on la retrouve en Turquie, en Russie, au Brésil ou en Hongrie. Mais dans le cas américain, elle prend une dimension mondiale, tant l’influence politique, économique et culturelle de ce pays est immense. Si les citoyens ne retrouvent pas confiance dans leurs institutions, d’autres figures autoritaires surgiront ailleurs pour imposer leur vision. Et ce jour-là, nous réaliserons peut-être que nous avons sacrifié la complexité et l’imperfection de la démocratie au profit de la simplicité brutale d’un pouvoir solitaire – un choix qui, comme dans les westerns, ne se termine jamais bien.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside