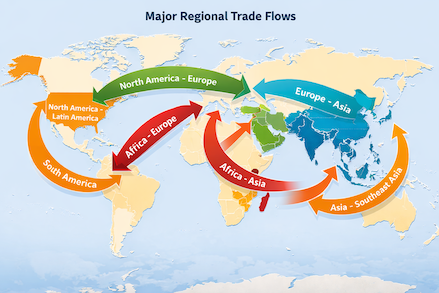L’argent dicte la loi, l’humain disparaît

De tout temps, les sociétés humaines ont été traversées par un principe fondamental, souvent implicite : la loi du plus fort. Qu’il s’agisse des luttes tribales, des empires conquérants ou des rapports de force économiques, cette règle universelle a dicté l’organisation des relations humaines et des structures politiques. Pourtant, le rêve moderne d’une démocratie équilibrée, d’alliances durables et d’accords respectés semblait avoir ouvert une parenthèse d’espérance. L’idée qu’un cadre légal et éthique puisse dominer la brutalité des rapports de force avait séduit l’Occident, inspirant des constitutions, des traités internationaux et des institutions censées garantir la justice. Mais la réalité contemporaine nous ramène cruellement à une évidence : dans un monde traversé par les crises, ce n’est plus le droit qui dicte les règles, mais l’ego et l’argent.
Les nouveaux visages du pouvoir
Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’épées, de boucliers ou de champs de bataille. La force s’exprime par des instruments plus sophistiqués : domination économique, puissance militaire dissuasive, emprise médiatique ou encore capacité d’influence numérique. Ceux qui détiennent ces leviers imposent leur volonté, reléguant les beaux discours sur la solidarité, l’éthique ou la dignité humaine au rang de décor diplomatique. Dans ce théâtre de faux-semblants, l’intérêt individuel et l’avidité financière deviennent les seuls véritables moteurs. La démocratie, jadis présentée comme un rempart, semble aujourd’hui fragilisée, voire contournée. Les urnes ne suffisent plus à garantir la voix des peuples, tant elles se voient manipulées par la désinformation, les campagnes orchestrées par des puissances étrangères ou la concentration des médias aux mains de quelques groupes. Les accords internationaux, eux, deviennent des textes creux que les plus puissants respectent ou bafouent à leur convenance. Quant aux alliances, elles ne tiennent que tant qu’elles servent l’intérêt immédiat des plus forts. Le multilatéralisme, censé équilibrer le monde, s’effrite devant la logique implacable du rapport de forces. Dans cette logique, les valeurs humaines s’effacent. La vie des personnes devient secondaire, presque une variable d’ajustement dans des équations où ne comptent que le profit et l’influence. Les conflits actuels, qu’ils soient armés ou commerciaux, en témoignent crûment : les victimes civiles, les populations déplacées, les générations sacrifiées ne pèsent rien face aux milliards de dollars investis dans l’armement, l’exploitation des ressources naturelles ou le contrôle des marchés stratégiques. L’éthique, jadis brandie comme une boussole, n’est plus qu’un outil de communication ou un slogan utilisé pour légitimer des décisions guidées par des intérêts égoïstes. La loi du plus fort ne se limite pas aux relations internationales. Elle traverse aussi les sphères économiques et sociales. Dans les entreprises, la quête du profit maximal écrase souvent les considérations humaines. Les salariés deviennent interchangeables, pressurisés par des logiques financières qui n’ont cure de leur bien-être ou de leur avenir. La culture du court terme, alimentée par les marchés boursiers et l’appétit des actionnaires, impose une cadence impitoyable. Là encore, la voix des faibles se perd dans le vacarme des puissants. Même dans nos sociétés dites avancées, cette règle se manifeste dans les inégalités croissantes. L’accès à la santé, à l’éducation ou même à une vie digne dépend de plus en plus du pouvoir économique. Les plus riches façonnent les règles du jeu à leur avantage, tandis que les plus vulnérables se retrouvent piégés dans un système qui prône l’égalité en façade mais pratique l’exclusion au quotidien.
Un paradoxe révélateur
Faut-il alors conclure que la loi du plus fort est une fatalité ? L’histoire semble nous l’enseigner : aucun système, aussi noble soit-il, n’a pu durablement l’éradiquer. Pourtant, des résistances existent. Chaque fois que des individus, des associations, des peuples s’organisent pour défendre leur dignité, ils rappellent que la force brute n’est pas la seule voie possible. Mais ces résistances peinent à s’imposer face aux mastodontes économiques et politiques qui dictent leur loi. Nous vivons ainsi dans un paradoxe : jamais les sociétés n’ont produit autant de discours en faveur de l’éthique, de la responsabilité sociale, du respect de la vie humaine ; et jamais ces valeurs n’ont été autant malmenées par des pratiques cyniques. La loi du plus fort n’a pas disparu : elle s’est simplement parée de nouveaux habits, plus modernes, plus discrets, mais tout aussi implacables.
Il appartient aux citoyens, aux dirigeants éclairés, aux intellectuels et aux penseurs de rappeler que la véritable force ne réside pas seulement dans l’argent ou la domination. Elle peut aussi se trouver dans la solidarité, la justice et la capacité à placer l’humain au cœur des choix collectifs. Tant que cette conviction ne redeviendra pas centrale, la loi du plus fort continuera d’imposer son règne silencieux, reléguant la démocratie, l’éthique et la dignité humaine au rang de simples illusions.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside