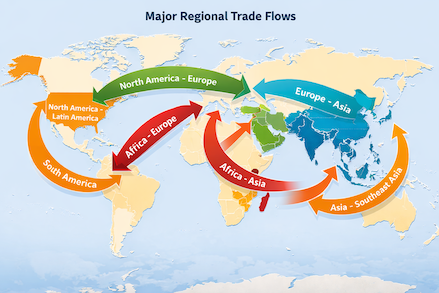La peur de l’autre : un défi toujours actuel

Depuis la nuit des temps, l’humanité s’est structurée autour de la distinction fondamentale entre le « nous » et le « eux », une frontière apparemment anodine qui a nourri des appréhensions profondes. La rencontre avec l’autre, qu’il soit d’une origine différente, d’une culture étrangère ou d’une religion nouvelle, a souvent été perçue comme une menace plutôt que comme un enrichissement. L’histoire regorge d’exemples où cette méfiance a engendré racisme, exclusion, ségrégation et conflits – un réflexe ancestral hérité d’une humanité soucieuse de protéger son territoire et ses ressources, qui traverse les siècles sans perdre de sa virulence. On aurait pu espérer qu’au XXIᵉ siècle, ère d’hyperconnexion et de mondialisation, cette dynamique se serait transformée. Les voyages n’ont jamais été aussi accessibles, les échanges culturels aussi intenses, et la diversité humaine n’a jamais été autant valorisée dans les discours officiels. Pourtant, la réalité dépeint un tableau différent : dans de nombreux pays, la xénophobie s’intensifie, l’intolérance se banalise, et la méfiance envers l’étranger ressurgit avec une violence inédite, comme si la modernité, loin d’apaiser les tensions, avait réveillé des instincts primitifs.
Cette persistance s’explique en partie par l’accélération des mutations sociales contemporaines. Face à des transformations rapides – crises économiques, flux migratoires, révolutions technologiques – une partie de la population éprouve un sentiment de désorientation. L’autre, celui qui arrive, celui qui pense ou croit différemment, devient alors le bouc émissaire idéal. L’intolérance et la xénophobie prospèrent dans ce climat d’incertitude, nourries par une impression diffuse de perte de repères. C’est moins l’individu lui-même qui inquiète que ce qu’il symbolise : une remise en cause d’un équilibre, d’une identité, d’un mode de vie établi.
Les plateformes numériques, censées rapprocher les peuples, contribuent paradoxalement à cette fragmentation. Elles propagent à une vitesse fulgurante des contenus, des slogans et des récits simplistes qui enferment les utilisateurs dans des chambres d’écho idéologiques. Les désinformations et les discours haineux y trouvent une caisse de résonance démultipliée. Quelques clics suffisent pour transformer des rumeurs en certitudes. Dans ce tumulte numérique, l’appréhension se nourrit davantage de stéréotypes et de manipulations que de rencontres authentiques.
Faut-il pour autant sombrer dans le pessimisme ? Rien n’est plus périlleux que de considérer la haine comme inéluctable. L’hostilité envers l’autre n’est pas une fatalité génétique, mais une construction sociale et culturelle. Si elle a pu être édifiée, elle peut également être déconstruite. Cela requiert de la détermination, de la persévérance et surtout une éducation orientée vers la compréhension mutuelle. Dès l’enfance, il est possible d’enseigner à valoriser la différence plutôt qu’à la redouter, à démontrer que l’autre constitue non pas un péril mais un miroir qui enrichit notre propre identité. Il convient également de rappeler que le respect ne se proclame pas, il se cultive quotidiennement. Dans les quartiers, sur les lieux de travail, au sein des associations, ce sont les interactions concrètes qui démantèlent les préjugés : le voisin aux traditions culinaires différentes, le collègue aux pratiques spirituelles distinctes, l’ami venu d’ailleurs. Autant de rencontres qui révèlent que l’humanité partage davantage de similitudes qu’elle ne cultive de divergences. La méfiance disparaît rarement face aux discours théoriques, mais elle s’estompe devant l’expérience vécue. Les dirigeants politiques et les acteurs médiatiques portent également une responsabilité considérable : ils peuvent choisir d’attiser les divisions pour séduire certains électeurs, ou au contraire rappeler inlassablement que l’unité naît du respect mutuel plutôt que de l’exclusion. Dans une époque saturée de messages instantanés et polarisants, la voix de la mesure et de la nuance doit être portée avec détermination. Aspirer à un monde exempt de haine et de violence n’est pas une utopie candide, c’est une nécessité vitale. Les sociétés qui s’enlisent dans la défiance envers l’autre se condamnent à la stagnation et aux conflits, tandis que celles qui embrassent la diversité puisent dans ce métissage une source de créativité, d’innovation et de dynamisme. Le défi est colossal, mais il commence par des attitudes simples : écouter avant de juger, dialoguer avant de condamner, accueillir avant de rejeter.
En définitive, l’avenir dépend de notre aptitude à transcender nos réflexes archaïques. Le XXIᵉ siècle ne sera véritablement progressiste que s’il parvient à transformer l’appréhension en respect, la suspicion en dialogue, la différence en force collective. L’hostilité envers l’autre ne doit plus constituer le fil rouge de notre histoire commune. Il est temps de lui substituer un autre moteur : celui de notre humanité partagée.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Inspiration