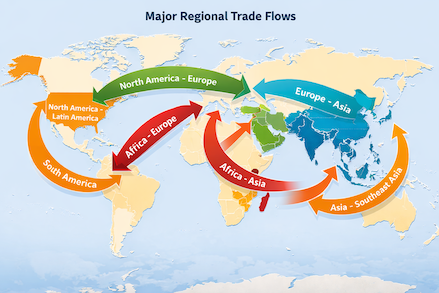La manipulation politique assumée
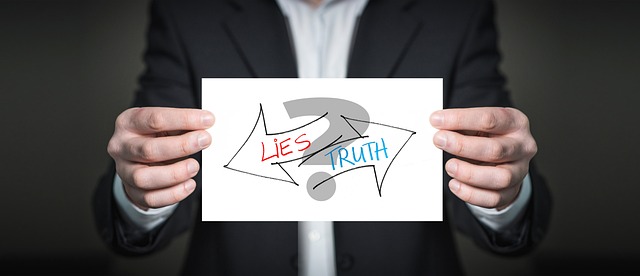
De tout temps, les politiques de tous les pays ont fait miroiter des miracles qu’ils savaient eux-mêmes irréalisables. Les promesses exagérées, les discours séduisants, les projets trop beaux pour être vrais ont toujours fait partie du théâtre politique. On pourrait presque en sourire, y voir un jeu connu, un mal nécessaire dans la quête du pouvoir. Mais ce qui autrefois relevait de la tactique est aujourd’hui devenu une stratégie bien plus inquiétante. Nous avons changé d’époque. Nous sommes passés à une vitesse supérieure. Désormais, certains dirigeants ne se contentent plus de tordre la réalité : ils la réécrivent. Des faits pourtant établis, documentés, prouvés, sont ouvertement niés. Mieux (ou pire) : ils sont revendiqués comme faux avec une assurance déconcertante. Et ce qui devrait provoquer une réaction immédiate de rejet est, dans bien des cas, accepté sans broncher par une partie de la population. Non seulement le mensonge ne choque plus, mais il est parfois accueilli comme une vérité alternative, voire comme une forme de courage politique.Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi les démocraties, qui devraient justement cultiver l’esprit critique, ont-elles failli à ce point ? Comment l’éducation, censée former des esprits libres et éclairés, a-t-elle perdu sa capacité à prémunir contre la manipulation ?
Une partie de l’explication réside dans la transformation rapide de nos sociétés. L’accélération constante du flux d’informations, la saturation des contenus, et la porosité croissante entre opinion et vérité ont brouillé nos repères collectifs. Les réseaux sociaux, en offrant à chacun une tribune, ont aussi offert à chaque mensonge une caisse de résonance décuplée. Dans cet espace numérique sans filtre, le vrai et le faux s’entrelacent, se répètent, se propagent et finissent par perdre toute distinction. À force d’être recyclées, les contre-vérités deviennent familières, et ce qui était évident hier devient flou aujourd’hui. Peu à peu, la réalité devient une zone grise où l’objectivité recule, remplacée par la croyance et l’émotion.Dans ce brouillard, certains leaders ont compris qu’il suffisait d’affirmer fort, de répéter souvent, pour que le doute s’installe. La remise en question des faits n’est plus une erreur, c’est une arme. Le doute devient un outil de domination. Et peu importe les preuves : si une partie du peuple veut croire, elle croira. Parce que la vérité, parfois, dérange. Parce qu’un mensonge bien calibré peut rassurer, flatter, mobiliser. Et parce que les émotions, dans la bataille de l’opinion, l’emportent souvent sur la raison.
Mais ce phénomène ne s’explique pas uniquement par les mutations technologiques ou les dérives de la communication. Il révèle un malaise plus profond : l’affaiblissement du sens civique et le recul du goût de la réflexion. Dans trop de pays, l’éducation a perdu de vue sa mission essentielle : former des citoyens éclairés, capables de penser par eux-mêmes. L’esprit critique, qui devrait constituer le socle de tout apprentissage, est souvent relégué au second plan, sacrifié sur l’autel des compétences techniques, des évaluations standardisées et des logiques de performance. Or, un citoyen qui ne doute pas, qui ne questionne pas, devient une cible facile pour les discours simplistes et manipulateurs. Face à cette dérive, il ne suffit plus de s’indigner. Il faut reconstruire patiemment une culture de la pensée, redonner à l’éducation sa fonction émancipatrice, réhabiliter la complexité face aux slogans, valoriser les voix qui osent la nuance, l’honnêteté, parfois même l’impopularité. Et surtout, il faut réapprendre à écouter, à confronter les idées, à chercher la vérité non pas dans ce qui rassure, mais dans ce qui éclaire.
Face à ces dérives, il devient urgent de raviver le goût de la vérité, de redonner de la valeur à la parole donnée, à la cohérence entre discours et action. Cela demande du courage — de la part des citoyens autant que des responsables publics — mais aussi de la patience, car reconstruire la confiance est un travail long et exigeant. Il ne s’agit pas d’aspirer à un monde sans erreurs ni contradictions, mais de refuser l’installation durable du mensonge comme norme. Il en va de la vitalité de nos démocraties, de la liberté de nos esprits et de notre capacité collective à imaginer un avenir plus lucide, plus juste, plus digne. Le combat pour la vérité n’est pas une posture intellectuelle : c’est une responsabilité civique, une exigence morale, et peut-être, dans le monde d’aujourd’hui, un véritable acte de résistance.
Retrouvez l’ensemble des nos articles Dirigeant