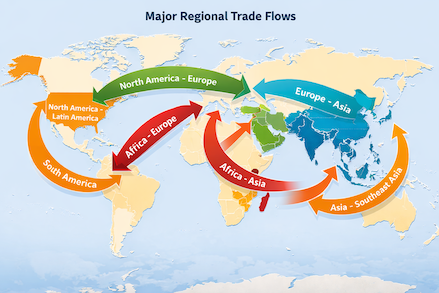Gaza : la fin de la guerre, vraiment ?

Les dirigeants se félicitent. Les micros s’allument, les drapeaux se déploient, les sourires s’affichent. La guerre est terminée, dit-on. Les discours évoquent une victoire, un retour à la sécurité, un nouvel espoir. Mais dans les ruines de Gaza, qui peut vraiment parler de victoire ?
Il y a, d’un côté, le souvenir des 1 200 Israéliens morts lors de l’attaque initiale, dans des conditions d’une barbarie insoutenable. Personne ne peut ni ne doit minimiser ce drame qui a marqué Israël au fer rouge, rappelant la vulnérabilité d’un pays pourtant habitué aux menaces. Mais de l’autre côté, 65 000 Gazaouis ont péri, selon les estimations locales. Des familles entières ont disparu. Gaza-ville n’est plus qu’un champ de gravats, et des pans entiers du territoire ressemblent désormais à une carte lunaire. Ce qui fut une cité animée, vibrante, est devenu un désert de béton et de poussière.
À Gaza, il n’y a plus rien à célébrer. Les survivants errent parmi les ruines à la recherche d’un peu d’eau, d’un proche, d’une photo épargnée. Les hôpitaux sont débordés, les écoles détruites, les infrastructures anéanties. Les ONG décrivent une situation humanitaire « apocalyptique ». Et tandis que le monde salue la fin des combats, c’est une autre guerre, plus silencieuse, qui commence : celle de la reconstruction, du deuil, de la mémoire. Comment reconstruire une ville qui n’existe plus ? Comment rebâtir une société entière quand elle a été broyée ? Et surtout, comment espérer la paix quand l’humiliation, la perte et la colère sont encore à vif ? Les Gazaouis n’oublieront pas ce qu’ils ont vécu. Comment effacer les images des bombardements, les cris, les corps sous les décombres ? Comment ne pas ressentir de la haine envers ce voisin qui vous a tout pris, même si l’on sait qu’elle ne mène à rien ? Cette guerre laissera des traces pour des générations. Elle n’a pas seulement détruit des bâtiments, elle a pulvérisé un tissu social, un sentiment d’appartenance, une confiance déjà fragile dans l’idée même d’humanité. Pour beaucoup, le mot « justice » n’a plus de sens.
On peut, bien sûr, se réjouir que les massacres aient cessé. On peut espérer que les armes se taisent durablement. Mais l’histoire de cette région nous a appris que la fin d’une guerre n’est souvent que la pause avant la suivante. Tant que les causes profondes, le blocus, la misère, l’absence de perspectives politiques, la colonisation, la peur, resteront sans réponse, le feu couve. Israël savoure aujourd’hui une victoire militaire au goût amer. Car au-delà des chiffres, il y a cette question morale : à quel prix ? Peut-on éradiquer un ennemi sans anéantir aussi la possibilité de vivre ensemble ? Peut-on prétendre à la sécurité en semant la désolation ? Les dirigeants israéliens affirment avoir rétabli la dissuasion. Peut-être. Mais dans les cœurs, c’est un ressentiment profond qui s’installe, prêt à se transmettre d’une génération à l’autre.
Du côté palestinien, la reconstruction sera titanesque. Pas seulement celle des immeubles, mais celle des êtres. Relever les murs est une chose, redonner un sens à la vie en est une autre. Et qui portera ce projet ? Le Hamas, affaibli mais toujours présent ? L’Autorité palestinienne, discréditée ? Ou la communauté internationale, qui promet de l’aide mais détourne vite le regard dès que la poussière retombe ? Les puissances régionales et occidentales parlent déjà de fonds, de plans de relance, de corridors humanitaires. Mais sans reconnaissance des torts, sans justice, sans horizon politique clair, ces promesses risquent de n’être qu’un pansement sur une plaie ouverte. Car la fin de la guerre à Gaza ne signe pas la paix. Elle ne signe même pas un apaisement. Elle marque simplement une transition entre la violence visible et la douleur muette. Et cette douleur, profonde, diffuse, collective, risque de nourrir le cycle que tous prétendent vouloir briser. Alors oui, la guerre est finie. Les dirigeants se congratulent. Mais à Gaza, sous les gravats, un peuple tente de respirer. Et il serait indécent, voire dangereux, de croire que tout peut simplement recommencer comme avant.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside