Quand l’égalité s’arrête à la surface
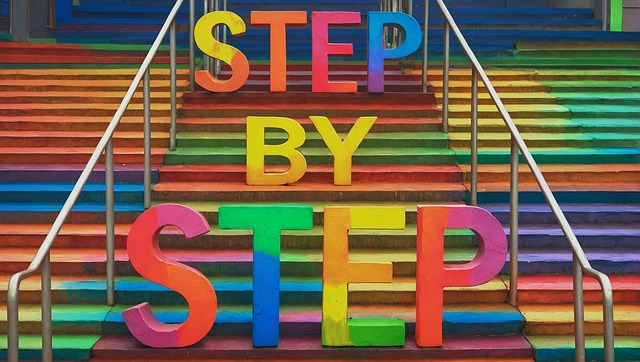
À première vue, les sociétés occidentales ont fait des avancées notables en matière d’égalité entre les sexes. Le droit de vote, l’accès aux études supérieures, l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, ou encore l’émancipation sexuelle et économique sont autant de victoires acquises de haute lutte. Pourtant, sous cette surface lisse, des résistances profondes subsistent. La femme reste encore, bien souvent, considérée comme le subalterne de l’homme. Et au-delà des lois, c’est toute une culture, tout un système de pensée et d’habitudes sociales qui continuent de lui assigner une position secondaire. Certaines tâches, notamment domestiques ou liées au soin, lui sont encore largement attribuées. Ce que l’on appelle aujourd’hui la « charge mentale » pèse de manière écrasante sur les épaules des femmes, même dans les foyers les plus « modernes ». Dans le couple hétérosexuel, il est encore courant que la femme organise la vie familiale, anticipe les besoins des enfants, gère les courses, les rendez-vous, les lessives… pendant que l’homme, même s’il « aide », reste souvent dans une posture passive, voire d’autorité. Ce déséquilibre s’observe aussi dans les sphères de pouvoir. En entreprise, en politique, dans les médias, les hommes dominent encore les fonctions de direction et de décision. Le plafond de verre, malgré les discours, reste bien réel.
Et lorsque les femmes s’affirment, elles se heurtent à un double standard : on les juge froides, agressives, autoritaires. Là où un homme sera vu comme ambitieux et déterminé, une femme sera taxée d’arrogante ou d’insensible. L’inconscient collectif peine à accepter la femme comme leader naturel. Elle doit encore trop souvent se justifier, composer, arrondir les angles, se montrer « aimable », alors même qu’on n’exige pas cela de ses homologues masculins. Mais le plus inquiétant, peut-être, reste l’expression extrême de cette inégalité : les féminicides. En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Dans d’autres pays occidentaux, les chiffres ne sont guère plus rassurants. Ces meurtres ne sont pas des drames isolés, ils sont le symptôme d’une société qui, dans ses recoins les plus sombres, considère encore que la femme est une propriété, un être à soumettre, et qu’un refus de se plier peut valoir une condamnation à mort. La domination masculine ne se limite donc pas à des attitudes paternalistes ou des inégalités salariales : elle tue.
Alors comment faire changer les mentalités ? Comment transformer en profondeur une société qui, malgré ses avancées juridiques, peine à reconnaître la femme comme l’égale véritable de l’homme ? La réponse est complexe, car elle implique un travail de longue haleine : éducation dès le plus jeune âge, représentations dans les médias, lutte contre les stéréotypes, exemplarité dans les sphères de pouvoir, soutien aux femmes victimes de violences, réforme des institutions encore patriarcales… Mais un autre aspect, plus subtil et souvent tabou, doit aussi être abordé : la manière dont certaines femmes elles-mêmes perpétuent ces schémas. Il est difficile, mais nécessaire, d’admettre que la domination masculine se reproduit aussi parce qu’elle est, parfois, acceptée, intériorisée, voire défendue par des femmes. Que ce soit par conformisme, par peur de sortir du cadre, ou par rivalité féminine, il arrive que des femmes se dressent les unes contre les autres, plutôt que de s’élever ensemble contre les injustices. Le sexisme intégré — cette forme d’autocensure ou d’auto-dévalorisation — est un obstacle puissant au changement. Lorsqu’une femme dénigre une autre pour son ambition, sa liberté ou son refus de se conformer aux codes traditionnels, elle alimente malgré elle le système qu’elle subit. Mais blâmer les femmes ne suffit pas. Car si certaines deviennent leurs propres ennemies, c’est bien parce que la société les a conditionnées à cela. Le vrai combat est donc celui de la conscience. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir des droits, mais de transformer les esprits. Et cela passe par une sororité active, une solidarité sincère entre femmes, un engagement des hommes à déconstruire leurs privilèges, et une volonté collective de bâtir une société enfin équitable.
Ce n’est pas par décret que l’égalité naît, mais par l’engagement quotidien de chacun à bâtir un monde plus juste.
Retrouvez l’ensemble de nos articles Inside








